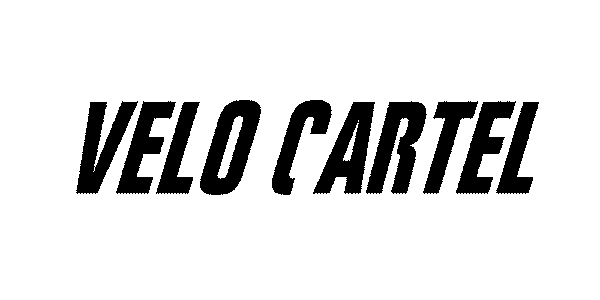Corsica Postcard
Aller voir le Tour à vélo
Je ne me souviens pas dans le détail de ma montée du col de Sorba. Je me rappelle seulement l’avoir franchi comme une fusée, de peur de manquer le passage du Tour.
30 juin 2013. Corse du Sud. Deuxième étape de la 100e édition du Tour de France que je couvre pour Le Devoir sur la bien nommée île de Beauté. Quoi de mieux que de s’y rendre en roulant avec les amis?
Nous faisons un bout de la route en voiture. De Porto-Vecchio jusqu’à Ghisonaccia, sur la côte Est. De là, au bord de la mer, nous avons tracé un chemin qui nous mènera au cœur des montagnes où se joue l’étape qui traverse l’île de part en part, de Bastia à Ajaccio.
J’ai consulté le grand livre de la course que l’on remet aux coureurs et aux médias. Les heures d’arrivée à chacun des points importants du trajet y sont projetées, selon la vitesse moyenne du peloton. Aussi, alors que nous remontons le cours du superbe fleuve U Fium’Orbu, je réalise que nous sommes partis un peu tard. Le temps manque pour nous la couler douce jusqu’au parcours. Les autres me disent : allez, vas-y, tu peux pas rater ça. Je m’excuse. Je fonce.
Dix ans plus tard, je regarde mon tracé sur Strava comme je relirais un cahier dans lequel on collige nos rêves. Des 1250 m de gain d’altitude gravis sur 30 km – dont environ 700 m sur les 10 dernières bornes de grimpe avalés d’un trait, cul sec, comme si ma vie en dépendait –, je ne conserve que quelques vagues souvenirs. Une Peugeot jaune croisée lors de mon passage dans le village de Ghisoni, l’odeur du maquis en plein soleil, à l’orée des bois, quelques maisons dans les premiers virages sous les arbres. La fraîcheur de l’ombre. Je me souviens surtout qu’une choses m’obsédait. Rater le passage du peloton. Et qu’à chaque fois que je me croyais arrivé au sommet, au point de bascule, un virage aveugle me menait vers une autre corniche, une autre montagne, ce qui alimentait ma crainte de tout manquer.
Mes souvenirs de mon arrivée tout en haut sont cependant limpides. J’arrête un instant pour admirer le paysage. J’ai le souffle coupé. À ce moment, dans ma vie cycliste, je n’ai rien vu de tel. Des cimes qui s’enfilent l’une derrière l’autre pour faire un collier à la ligne d’horizon. Des sommets enneigés à la fin juin. Puis je contemple ce qui se trame tout en bas : des lacets bien tassés comme je n’en ai jamais descendu jusqu’alors.
Devant moi, deux papys néerlandais s’élancent sur leurs bécanes en acier qui paraissent avoir été empruntées au musée. Au premier virage, ils me larguent. Je ne comprends rien à la technique de descente, je suis pétrifié, toujours à freiner au mauvais moment, il me faut une éternité pour atteindre Vivario, 700 mètres plus bas, et le petit chalet de montagne où s’amassent les autos, les motos et les fans. J’ai mal aux mains, je me sens vraiment nul. (Quelques années plus tard, j’apprendrai enfin comment négocier la descente des cols.)
Mes mauvais sentiments s’évanouissent rapidement. Les hélicos de la télé vrombissent dans le ciel et s’approchent lentement. De loin, ils paraissent immobiles. Les cohortes de flics à moto et de VIP en auto déboulent sur la route. C’est ma seconde expérience du Tour en autant de jours et un frisson me parcourt l’échine. Je mesure pour la première fois l’ampleur de la chose. Sa démesure. Sa folie.
Le bruit augmente. Il y a toujours plus de voitures, de klaxons. On entend la foule hurler de loin. Les hélicos sont au-dessus de nous quand mes amis arrivent enfin, juste à temps pour voir David Veilleux, survivant de l’échappée du jour, être repris par le peloton.
Les bombes à confettis explosent de partout. Les fumigènes colorent le ciel d’orange, de jaune, de rose. La foule exulte, comme possédée. Puis les voitures d’équipes suivent à une vitesse ahurissante. Le temps suspend son vol. Je cours me chercher un Coke, en profite pour regarder un peu de la course sur la télé dans le chalet qui sert de resto avant de revenir pour constater les dommages : le gruppetto des sprinteurs et des domestiques peine dans l’une des dernières bosses catégorisées du jour, en équilibre entre l’économie de l’effort et la limite de temps imposée par les meneurs.
Puis, d’un coup, tout est fini. Les hélicos partis. Ne reste que la rumeur de la foule pour remplacer ses cris. Les côtés de la route se vident.
Nous remontons en selle. Le retour, contrairement à l’aller, est inscrit seconde par seconde dans ma mémoire. Nous rions en enfilant les lacets sans trop peiner, portés par l’excitation de la foule. Puis nous redescendons tant bien que mal vers la voiture à travers celles qui repartent en empruntant une des deux seules routes accessibles pour retrouver la côte.
Le trafic, trop dense, nous ennuie un peu. Il y a une belle terrasse au snack bar Place de la Fontaine à Ghisoni. Nous avons faim et soif. Bon prétexte pour s’arrêter et laisser les voitures s’éparpiller. Deuxième coup de chance de la journée : un écran géant diffuse la course et nous pouvons voir les 10 dernières bornes de l’étape. Jan Bakelants part en solo sur le dernier kilomètre, pourchassé sans être repris. Sa plus belle victoire en carrière, sans doute. Une autre émotion puissante s’ajoute à toutes celles qui sont venues émailler ce jour de rêve.
Une longue et rapide descente en faux plat nous attend pour la fin du parcours. J’ai cette fois le temps de contempler le paysage dans la gorge taillée par le fleuve que nous longeons. S’il y a quelque chose qui brille dans mon regard, c’est un peu la fatigue, et beaucoup la magie du Tour.
Je ne me souviens pas dans le détail de ma montée du col de Sorba. Je me rappelle seulement l’avoir franchi comme une fusée, de peur de manquer le passage du Tour.
30 juin 2013. Corse du Sud. Deuxième étape de la 100e édition du Tour de France que je couvre pour Le Devoir sur la bien nommée île de Beauté. Quoi de mieux que de s’y rendre en roulant avec les amis?
Nous faisons un bout de la route en voiture. De Porto-Vecchio jusqu’à Ghisonaccia, sur la côte Est. De là, au bord de la mer, nous avons tracé un chemin qui nous mènera au cœur des montagnes où se joue l’étape qui traverse l’île de part en part, de Bastia à Ajaccio.
J’ai consulté le grand livre de la course que l’on remet aux coureurs et aux médias. Les heures d’arrivée à chacun des points importants du trajet y sont projetées, selon la vitesse moyenne du peloton. Aussi, alors que nous remontons le cours du superbe fleuve U Fium’Orbu, je réalise que nous sommes partis un peu tard. Le temps manque pour nous la couler douce jusqu’au parcours. Les autres me disent : allez, vas-y, tu peux pas rater ça. Je m’excuse. Je fonce.
Dix ans plus tard, je regarde mon tracé sur Strava comme je relirais un cahier dans lequel on collige nos rêves. Des 1250 m de gain d’altitude gravis sur 30 km – dont environ 700 m sur les 10 dernières bornes de grimpe avalés d’un trait, cul sec, comme si ma vie en dépendait –, je ne conserve que quelques vagues souvenirs. Une Peugeot jaune croisée lors de mon passage dans le village de Ghisoni, l’odeur du maquis en plein soleil, à l’orée des bois, quelques maisons dans les premiers virages sous les arbres. La fraîcheur de l’ombre. Je me souviens surtout qu’une choses m’obsédait. Rater le passage du peloton. Et qu’à chaque fois que je me croyais arrivé au sommet, au point de bascule, un virage aveugle me menait vers une autre corniche, une autre montagne, ce qui alimentait ma crainte de tout manquer.
Mes souvenirs de mon arrivée tout en haut sont cependant limpides. J’arrête un instant pour admirer le paysage. J’ai le souffle coupé. À ce moment, dans ma vie cycliste, je n’ai rien vu de tel. Des cimes qui s’enfilent l’une derrière l’autre pour faire un collier à la ligne d’horizon. Des sommets enneigés à la fin juin. Puis je contemple ce qui se trame tout en bas : des lacets bien tassés comme je n’en ai jamais descendu jusqu’alors.
Devant moi, deux papys néerlandais s’élancent sur leurs bécanes en acier qui paraissent avoir été empruntées au musée. Au premier virage, ils me larguent. Je ne comprends rien à la technique de descente, je suis pétrifié, toujours à freiner au mauvais moment, il me faut une éternité pour atteindre Vivario, 700 mètres plus bas, et le petit chalet de montagne où s’amassent les autos, les motos et les fans. J’ai mal aux mains, je me sens vraiment nul. (Quelques années plus tard, j’apprendrai enfin comment négocier la descente des cols.)
Mes mauvais sentiments s’évanouissent rapidement. Les hélicos de la télé vrombissent dans le ciel et s’approchent lentement. De loin, ils paraissent immobiles. Les cohortes de flics à moto et de VIP en auto déboulent sur la route. C’est ma seconde expérience du Tour en autant de jours et un frisson me parcourt l’échine. Je mesure pour la première fois l’ampleur de la chose. Sa démesure. Sa folie.
Le bruit augmente. Il y a toujours plus de voitures, de klaxons. On entend la foule hurler de loin. Les hélicos sont au-dessus de nous quand mes amis arrivent enfin, juste à temps pour voir David Veilleux, survivant de l’échappée du jour, être repris par le peloton.
Les bombes à confettis explosent de partout. Les fumigènes colorent le ciel d’orange, de jaune, de rose. La foule exulte, comme possédée. Puis les voitures d’équipes suivent à une vitesse ahurissante. Le temps suspend son vol. Je cours me chercher un Coke, en profite pour regarder un peu de la course sur la télé dans le chalet qui sert de resto avant de revenir pour constater les dommages : le gruppetto des sprinteurs et des domestiques peine dans l’une des dernières bosses catégorisées du jour, en équilibre entre l’économie de l’effort et la limite de temps imposée par les meneurs.
Puis, d’un coup, tout est fini. Les hélicos partis. Ne reste que la rumeur de la foule pour remplacer ses cris. Les côtés de la route se vident.
Nous remontons en selle. Le retour, contrairement à l’aller, est inscrit seconde par seconde dans ma mémoire. Nous rions en enfilant les lacets sans trop peiner, portés par l’excitation de la foule. Puis nous redescendons tant bien que mal vers la voiture à travers celles qui repartent en empruntant une des deux seules routes accessibles pour retrouver la côte.
Le trafic, trop dense, nous ennuie un peu. Il y a une belle terrasse au snack bar Place de la Fontaine à Ghisoni. Nous avons faim et soif. Bon prétexte pour s’arrêter et laisser les voitures s’éparpiller. Deuxième coup de chance de la journée : un écran géant diffuse la course et nous pouvons voir les 10 dernières bornes de l’étape. Jan Bakelants part en solo sur le dernier kilomètre, pourchassé sans être repris. Sa plus belle victoire en carrière, sans doute. Une autre émotion puissante s’ajoute à toutes celles qui sont venues émailler ce jour de rêve.
Une longue et rapide descente en faux plat nous attend pour la fin du parcours. J’ai cette fois le temps de contempler le paysage dans la gorge taillée par le fleuve que nous longeons. S’il y a quelque chose qui brille dans mon regard, c’est un peu la fatigue, et beaucoup la magie du Tour.