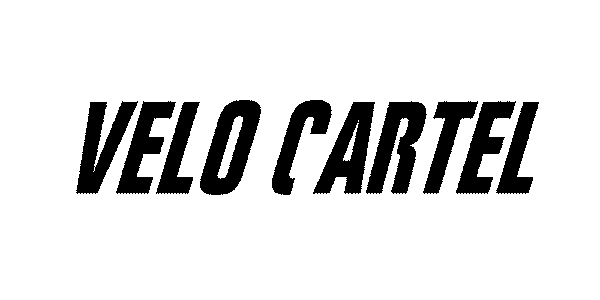Se souvenir des belles choses
J’avais tant besoin de changer de lumière.
La voilà qui se déployait enfin, douce et ambrée, filtrant à travers les feuilles pour faire danser ses dentelles d’ombres sur une route perdue, sans voitures, qui zigzaguait à flanc de montagne. Invisibles au monde, sous la frondaison de grands arbres, nous roulions depuis 30 minutes et je me sentais déjà neuf, lavé par l’air des montagnes, rincé par les rayons du soleil qui déclinait et dont nous tentions de rattraper la chute en nous lançant vers l’autre côté d’une vallée encore inondée de lumière.
En sortant de Foix, nous avions navigué à l’aveugle. L’avion avait atterri à Toulouse à peine quelques heures plus tôt. La voiture avait été louée, l’autoroute parcourue, les vélos extraits de leurs coquilles de transport et remontés à la hâte dans le garage du petit hôtel. Suffisait de lever les yeux pour voir les montagnes, dressées, vertes, belles comme une promesse tenue.
Nous nous sommes élancés, un peu chiffonnés par le voyage et le décalage, mais portés par l’enthousiasme des premières heures en cols étrangers. Dans le village, un homme est tombé de son vélo de ville sans se faire mal, en maugréant contre ses sandales qu’il tenait pour responsables de sa chute. La terrasse du café était presque déserte. Nous avons filé vers les bosses qui s’élevaient devant. Fermes décaties et maisons en décrépitude ponctuaient notre route. L’Ariège est un des départements de France les moins peuplés. Mal aimé, et pourtant d’une splendeur inoubliable.
Un virage ici, un autre là, quelques regards jetés sur l’iPhone pour avoir une idée d’où nous nous dirigions, et sans nous en rendre compte, le temps de quitter les pâturages, de saluer une apicultrice qui retournait à ses ruches, nous avions atteint ce nulle part que je cherche toujours à vélo. Une route inconnue, loin de mes habitudes.
J’avais fui celles-ci avant qu’elles ne m’écrasent. Travail à la chaîne. Sorties à vélo répétitives et enfoncées de force dans un agenda obèse dont les coutures craquaient. Repas inhalés. L’été avait passé comme ça. Comme un exercice disciplinaire. Il était temps de fuir.
La route devant nous était sauvage. Son pavage granuleux, ici et là traversé de bandes végétales, trahissant autant la vétusté du chemin que son anecdotique fréquentation. Nous poussions de gros braquets sur le long lacet, calé dans le flanc de la montagne, sorte de siège mouvant permettant de mieux admirer la vallée presque déserte en contrebas. Vaguement inquiets d’être rattrapés par les ombres qui imposent leur règne parfois un peu brusquement en montagne, nous avions accéléré le rythme naturellement, sans nous concerter. Notre discussion avait laissé place aux halètements et à nos monologues intérieurs. Le mien en était un de gratitude, de la nécessité, pour les semaines à venir, d’engranger les images et autres sensations afin d’en tapisser ma mémoire avec force détails. Je pourrais y revenir au besoin, sorte de temple intérieur où aller me recueillir lorsque la vie reprendrait sa forme habituelle de course contre le temps.
Au bout de notre effort, la température a un peu chuté. J’enfile ma veste. Plus de 10 bornes de descente rapide sur une petite route départementale nous attendent. Un enchaînement de lacets facilement négociables sans avoir à trop freiner qui paraît sans fin, au bout d’un moment. Nous traversons village après village pour revenir sur Foix, esquissant un passage par la vieille ville, son château juché tout en haut comme point de repère. Dans quelques minutes, le soleil se couchera derrière l’écrin montagneux qui nous entoure. Surtout, encore une fois, je prends un moment pour réaliser ma chance d’être ici. Pour me souvenir de tout. Pour que jamais ne meurent les belles choses.