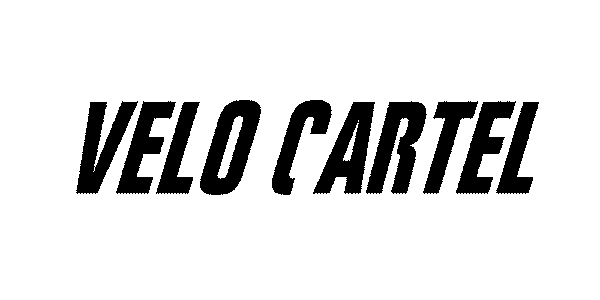Et le plaisir?
Les secondes s’égrènent avec une lenteur sadique. Mes jambes me supplient de mettre fin à la torture. Mon souffle irrite mes bronches. Je n’arrive plus à garder le haut de mon corps détendu; tous mes membres se crispent et les jointures de mes mains pâlissent à force de comprimer le guidon.
Si je pouvais garder la bouche fermée, je serrerais les dents, mais j’attrape chaque bouffée d’air comme si c’était la dernière, avec une grimace qui traduit un sentiment qui s’apparente au désespoir.
Et j’aime ça. Pas la douleur elle-même. Pas ce détestable moment qui témoigne de la relativité du temps, alors que chaque période de récupération me semble de plus en plus courte, et chaque effort, bien que de durée égale, de plus en plus long.
Ce que j’aime, c’est l’idée derrière la douleur. Sa logique. J’aime l’entraînement : ce processus par lequel on affûte un corps et on le met à sa main.
La lente progression. Les reculs. Les nouvelles avancées. Les bonnes journées et même les mauvaises qui nous obligent à revoir nos plans, à tirer des enseignements sur ce qui fonctionne pour nous, ou non, sur ce qui aide notre corps à être plus performant. Il y a quelque chose de beau et pur dans tout cela. L’idée que cette force est objective, qu’elle m’appartient entièrement.
Dans un monde où le travail est l’objet de critiques, et sa qualité, souvent une affaire d’opinions, la puissance du corps est rassurante en cela qu’elle s’exprime sans être jugée par une force externe. Les chiffres disent une vérité : celle de ma forme physique et mentale à ce moment précis de ma vie.
Et le plaisir dans tout cela?
C’est la grande tracasserie des gens qui ne bougent qu’en se gardant assez de souffle pour siffler la mélodie que leur cerveau leur passe en boucle depuis qu’ils l’ont entendue au supermarché. Ceux-là, lorsqu’ils me voient aller, me regardent d’un œil inquiet, croyant avoir affaire à quelque masochiste qui ne retire comme unique plaisir dans le sport que celui du spectacle de sa propre souffrance.
Ils ne comprendront peut-être jamais à quel point ils se trompent.
Mais ils n’ont pas entièrement tort à propos du spectacle. En ce sens que je me considère comme une sorte d’artiste de la douleur. Et que l’entraînement est une répétition en prévision des représentations à venir.
L’idée, c’est de parfaire une technique. Ici : pédaler bien et fort pour aller vite. L’effort brutal des intervalles, c’est faire des gammes. C’est reproduire des modèles anatomiques au fusain. C’est refaire une arabesque jusqu’à la perfection du geste. C’est intégrer une émotion pour la rendre de manière à la faire vivre au public.
Et c’est en même temps la fabrication d’une machine dont on repousse les limites et avec laquelle on apprend jusqu’où aller trop loin.
Le plaisir vient ensuite. Dans ce que l’on en retire. Les courses, les vraies. Mais aussi, et peut-être plus encore, les sorties entre amis, où l’on bataille jusqu’à une pancarte, ou le haut d’une bosse. C’est le col interminable que l’on franchit, lors d’un voyage, avec l’envie d’en enfiler plusieurs encore, parce qu’on le peut et que l’effort rendu normal par l’entraînement se noie dans les paysages sublimes, les virages célestes et l’exotisme général du lieu.
C’est le moment de la représentation. C’est le spectacle que l’on met sur pied pendant la saison morte, répétant le même geste avec l’immense patience nécessaire pour arriver à franchir chaque étape, le corps en entier tendu vers l’objectif qui est là, devant, comme une lumière au bout de l’hiver.
Il est là, le plaisir. Le bonheur de se savoir plus vivant que d’ordinaire. D’avoir la forme. De se sentir pousser des ailes, en sachant qu’on les a soi-même fabriquées. Et que même au sommet du plus haut col, par l’été le plus caniculaire, ni le soleil ni les esprits chagrins qui condamnent mon obsession ne les feront fondre.