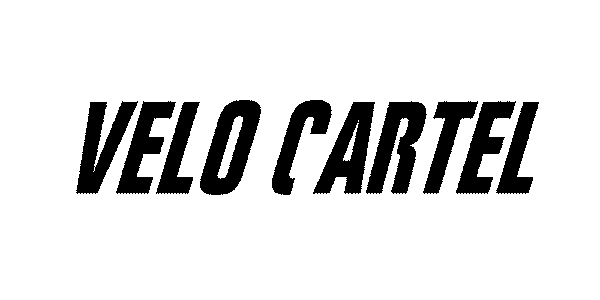Des cartes postales dans la tête
Je m’éveille ailleurs que chez moi. Dans une chambre d’hôtel, d’auberge. Chez des gens. Dans un appartement, un chalet. Je suis parti et j’ai fait des heures de route ou d’avion ou de train ou tout cela. Pour rouler. Parce que je ne connais pas de plus belle manière de découvrir le monde.
Je suis avec ma fiancée. Ou des amis. Peut-être seul. Un vélo de route, de gravier ou de montagne à mes côtés. À peine ai-je ouvert l’œil que j’envisage l’itinéraire du jour, ignorant ce qui m’attend en matière de rencontres, de paysages, de gens.
J’avale mon déjeuner, puis les kilomètres. Partout où je m’arrête, ou presque, on s’intéresse à moi.
En voyage, le vélo est un lubrifiant social. Que vous soyez seul ou en groupe, les habitants du coin de pays que vous découvrez et où vous vous arrêtez pour acheter à boire et à manger vous abreuvent de questions.
D’où êtes-vous? Et vous venez ici pour rouler? Oui messieurs-dames. C’est le paradis, ici.
Tant ici qu’ailleurs, les gens ignorent souvent la beauté dans laquelle s’écoule leur quotidien. Normal. On s’habitue à tout, même au grandiose. Le cycliste de passage leur rappelle la splendeur du décor qui les entoure. J’ai souvent le sentiment, en vantant leur propre pays, d’être pour eux un vecteur de fierté.
Et puis on me considère autrement à vélo que lorsque je débarque quelque part en voiture. En auto, je suis un intrus. En vélo, je m’invite encore, mais sur la pointe des pieds. J’ai fait un effort pour arriver ici. Cela semble susciter un certain respect.
Et cela rappelle qu’on peut visiter le monde autrement.
Même le rouleur aguerri pratique un tourisme de la lenteur. Ahanant dans d’interminables cols, il s’abreuve de l’immensité des montagnes qui s’offre à lui. Il avance à un rythme différent, collectionnant mentalement des cartes postales pour son propre usage. Dans l’effort, le rythme méditatif de sa cadence le fait réfléchir. Il absorbe le lieu en entier et cela se mêle à son identité.
Partout où je vais, je me fabrique un album d’expériences humaines qu’aucun Instagram du monde ne peut reproduire. Sorte de compendium de pensées, de réflexions existentielles et autres composantes d’un monologue intime qui s’attache à des photos comme un bas de vignette. Il est toujours avec moi. Dans le cloud de ma mémoire.
Le cycliste fuit la ligne droite des autoroutes. Il emprunte les routes ancestrales. Les bords de mer qui traversent des villages bondés comme oubliés. Les cols montagneux que les ancêtres ont dessinés pour y faire circuler les chevaux, ou que des militaires ont tracés pour que des ânes y tirent des canons entre deux fronts inhospitaliers. Routes sinueuses, parfois en territoire hostile, mais qui sont dessinées dans un souci d’apaisement de l’effort.

Que je sois seul ou avec d’autres, ces voyages de vélo sont pour moi à l’image de ces tracés. Sinueux. Imposant la lenteur. Forçant le regard à porter loin devant pour mieux voir la beauté qui nous entoure. Et cela me permet d’être mieux avec moi-même comme avec celles et ceux qui partagent mon périple.
Il y a dans cette expérience du monde quelque chose d’à la fois simple et sublime. Le corps, la tête et le cœur qui avancent ensemble. Des histoires qui s’écrivent au fil des kilomètres parcourus. Parfois des drames. Une chute. Un vol. Une perte. Un jour «sans». Des fous rires interminables. Une solitude assumée ou de beaux et heureux silences «ensemble».
Puis je reviens. Je m’éveille chez moi. Et à peine ai-je ouvert l’œil que je songe au prochain voyage.