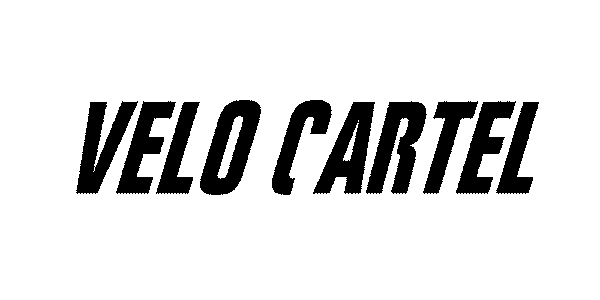Au bout de soi
Goûter le sang dans sa bouche. Sentir les fibres musculaires se rompre jusqu’à la paralysie, jusqu’à ce que chaque membre prenne l’intransigeante consistance du béton armé. Accepter la brûlure des bronches comme un tribut consenti à l’ultime effort. Les mains blanches d’avoir trop serré le guidon. Les pieds engourdis. Le dos qui élance, des vertèbres lombaires jusqu’entre les omoplates. La pulsation du sang qui résonne dans les tempes comme le tambour d’une horde guerrière.
Le front appuyé sur l’avant-bras, ou assis, la tête entre les genoux, le regard rivé au sol, il n’existe plus rien que les déchets produits par l’intense et magnifique déploiement de force humaine dont on vient de faire preuve. Ils se répandent dans un corps qui irradie, suinte, pleure d’avoir tant souffert. Parfois, une nausée. Un étourdissement.
Plus tard, après le rush d’endorphines, après la douce extase, viendra la lourde fatigue que seul le sommeil pourra réparer. Puis il faudra recommencer.
Aller au bout de soi se paye. Mais cela rapporte aussi. C’est la variable de l’équation que celles et ceux qui n’ont jamais touché cette frontière du corps et de l’esprit ne peuvent calculer. Ce n’est pas leur faute. Il leur manque des données.
Cette inconnue, c’est un morceau d’une vie augmentée, améliorée par cette connaissance et cette gratitude envers soi d’avoir pu atteindre un tel degré d’abnégation. C’est le savoir exclusif que partagent les sportifs qui expérimentent, qui préfèrent tutoyer la possibilité de l’échec plutôt que de se prélasser dans le confort des habitudes.
Voilà pourquoi j’aime l’entraînement. Et la compétition. Les deux permettent de tenter ce que l’on croyait impossible. D’y parvenir, parfois, mais pas toujours. Et de se relever pour recommencer, encore, et encore, jusqu’à l’obtention du résultat convoité.
J’ai 44 ans. Je ne me lasse pas de l’idée de repousser un peu plus loin cette frontière. De l’empêcher de perdre du terrain avec les années. De jouer de mon corps comme d’un instrument que l’on affûte; une arme prête à être dégainée, peu importe l’occasion. Tout compte. La qualité du geste, l’efficacité du mouvement, la position, la technique, la stratégie.
C’est d’autant plus difficile à comprendre que de regarder les professionnels ne nous informe guère sur les profondeurs abyssales dans lesquelles nous devons parfois puiser, physiquement et mentalement, pour ne pas craquer. Les pros portent l’impassible masque du jeu, de cette partie de poker qu’est la compétition, alors qu’on tente de dire à son voisin qu’il souffre plus que nous, qu’il ferait mieux d’abandonner puisqu’il n’a aucune chance de remporter la mise.
On apprend aussi à dessiner ce masque à l’entraînement. Surtout avec un miroir devant soi, tandis qu’on encaisse les séries d’efforts sur le rouleau, affinant sa position et apprenant à jouer la comédie tandis qu’à l’intérieur de soi se déroule un drame. L’envie de l’abandon, de la résignation.
Aller au bout de soi, c’est parfois franchir la frontière, s’effondrer. C’est une école où l’on est sa propre matière. Glaise que l’on façonne. Données que l’on compile et analyse. Technique que l’on peaufine afin de tromper ses peurs, et de brouiller le signal que nous envoie le cerveau lorsqu’il nous commande de cesser de faire subir pareille agression au corps.
Je ne suis jamais déçu de mes échecs lorsque je navigue à la lisière de mes possibles. Ils m’informent sur moi. Ils me disent ce qu’il faudra faire mieux, ou autrement. Ils m’obligent à trouver conseil auprès de professionnels. Ils m’apprennent la résilience et m’endurcissent.
La frontière recule parce que j’y travaille. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais j’ai envie, là encore, d’aller jusqu’à la limite.