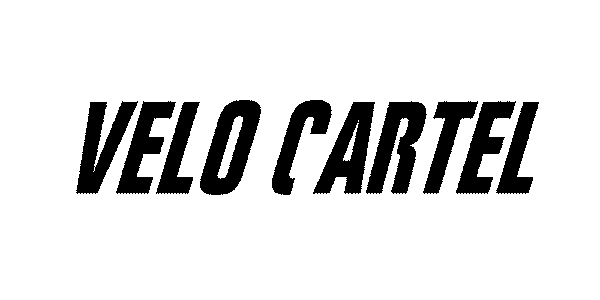À bloc!
Les sorties difficiles qu’on passe «dans le dur», en mode survie, sont à la fois l’occasion d’aiguiser sa forme et d’affûter son esprit. Récit d’un moment pénible mais profitable qu’a vécu David Desjardins.
Bruno se laisse glisser à ma hauteur et propose que nous prenions des relais.
«OK, mais pas trop fort.»
J’aurais pu ne rien dire du tout que ça n’aurait rien changé. Nous avons quitté la ville avec un vent de dos, tournant de gros braquets, profitant de la poussée éolienne pour atteindre des vitesses démesurées qui font gronder nos roues de carbone.
Mais dès la longue montée vers Sainte-Brigitte, depuis Beauport, nous en avons rajouté deux couches. Je prends mon relais devant la carrière de sable où nous croisons un groupe de kamikazes à motocross. Eux brûlent du gaz, moi je consume des cartouches. Et d’une. Et de deux. Mes présences à l’avant se feront sporadiques. Symboliques.
Je m’approche de cette sensation où tout mon corps ressent la douleur d’un effort pourtant essentiellement fourni par mes jambes. Mes bronches aussi commencent à s’irriter. Je déteste ça. J’adore ça. Je sais que ce que je fais ici est payant : rouler avec plus fort que moi, être repoussé dans mes retranchements. Un entraînement de qualité, d’intensité continue, qui me place souvent à la limite. Pendant longtemps.
Ce n’est pas une course, mais à certains moments, l’ardeur que nous y mettons m’y fait penser. Et il n’existe rien de mieux qu’une situation comme celle-ci pour mesurer son niveau de forme et s’obliger à mobiliser une part de soi que le cerveau commande souvent de conserver au vestiaire : ce qu’on est capable d’accomplir même quand on pense avoir atteint sa limite.
Du point de vue de la forme, l’été, je n’aime rien de plus que ces sorties exigeantes. Dans le cas qui nous occupe, je viens de faire 1h30 à une puissance normalisée qui équivaut à 86 % de mon CP20 (effort maximum soutenu sur 20 minutes). En salle, quand je tiens 80 %, je suis très content. Je reproduis dehors l’effet d’entraînement du groupe à l’intérieur. Et ici, la puissance de celui avec qui je roule constitue une énorme motivation : surtout, ne pas lâcher.
Lorsque nous arrivons à la base de la côte du Calvaire, je suis déjà cuit. Ma respiration est un râle. Je rêve d’un pignon supplémentaire. Pendant ce temps, Bruno grimpe sur la plaque devant moi. 53-23. Il lui reste encore du mou. Le salaud.
Je pourrais me décourager. Mais cela me fouette. Je sais qu’il pourrait me larguer. Qu’il m’attend. Mais je sais aussi que nous allons assez rapidement, depuis longtemps, et que le seul fait que je sois encore là à pousser comme un enragé témoigne de ma forme et des efforts consentis durant l’hiver.
J’ai mal au dos, aux jambes, aux bras. Au retour, les données offrent une trame objective à l’histoire que raconte mon corps. J’observe le chiffre qui témoigne du stress physique provoqué par une si courte sortie (le TSS, pour training stress score) et je suis étonné. Le coût est important. Mais il s’agit d’un investissement sur ma forme. Les sorties rapides sont des coups portés au corps, on a la sensation d’avoir été pilonné, comme un boxeur. Et en même temps, le mélange de fierté et du sentiment de puissance qu’on en tire est aussi inestimable pour la confiance que la forme qu’elles nous procurent.